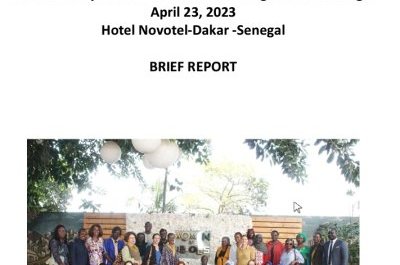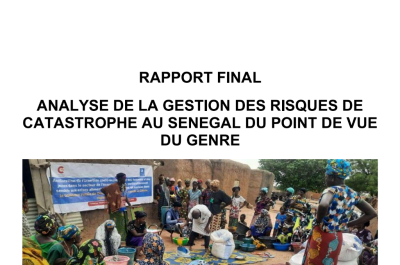Plus que des victimes : comment les femmes sénégalaises transforment le risque en opportunité
Imaginez Awa, une femme pleine de vie originaire d’un village côtier du Sénégal. Ses journées étaient rythmées par le raccommodage des filets de pêche avec son mari, l’entretien de son petit jardin débordant de légumes colorés, et le soin de ses trois enfants. La vie n’était pas facile, mais elle était prévisible, ancrée dans le flux et le reflux familier des marées.
Puis sont venues les inondations. Des pluies incessantes ont fait déborder la rivière, qui a englouti les maisons et les champs dans son étreinte boueuse. Le jardin d’Awa, sa bouée de sauvetage, a été submergé. Les bateaux de pêche ne pouvaient plus sortir. La peur, le froid et la faim se sont installés sur le village comme un brouillard épais. Awa sentit un nœud d’anxiété familier se serrer dans sa poitrine, un sentiment que de nombreuses femmes de sa communauté connaissaient bien. Elles étaient souvent les premières et les plus durement touchées, leurs petites entreprises et le bien-être de leur famille étant si précairement équilibrés.
Mais cette fois, c’était différent. Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, une femme nommée Fatou est arrivée de la capitale. Fatou ne se contentait pas d’offrir de l’aide ; elle posait des questions, écoutant attentivement les histoires des femmes. Elle a parlé d’analyse de genre, de la nécessité de comprendre comment les inondations les avaient affectées de manière unique, de la perte de leurs parcelles de légumes (souvent leur seule source de revenus) au fardeau accru des soins aux familles déplacées.
Awa était au début sceptique. Quel était le rapport entre l’analyse du genre et la reconstruction de leurs vies ? Mais Fatou a expliqué qu’en comprenant leurs vulnérabilités spécifiques, l’aide pouvait être mieux ciblée. Elle a souligné que les femmes avaient souvent moins accès aux informations sur les catastrophes imminentes et étaient moins susceptibles d’être incluses dans les processus de prise de décision de la communauté.
Inspirées par les mots de Fatou, Awa et d’autres femmes du village ont commencé à s’organiser. Elles ont partagé leurs expériences, identifié leurs besoins les plus urgents et élu des représentantes pour parler en leur nom lors des réunions de relèvement du village. Pour la première fois, leurs voix étaient vraiment entendues.
Elles ont parlé de la nécessité de disposer de semences résistantes à la sécheresse pour leurs jardins, de formations à des activités génératrices de revenus alternatives qui ne dépendent pas uniquement de la météo, et d’un accès à des systèmes d’alerte précoce adaptés à leurs besoins. Elles ont même soulevé des préoccupations concernant l’augmentation des risques de maladies et la pression supplémentaire exercée sur les femmes en tant que principales dispensatrices de soins.
Leur plaidoyer n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Les autorités locales, désormais plus conscientes des impacts genrés de la catastrophe, ont travaillé avec l’organisation de Fatou pour mettre en œuvre des programmes qui répondaient spécifiquement aux besoins des femmes. Elles ont reçu des formations sur de nouvelles techniques agricoles, des micro-prêts pour démarrer de petites entreprises, et des campagnes d’information ont été lancées via des canaux qui les atteignaient efficacement.
Lentement, le village a commencé à guérir. Awa a replanté son jardin avec de nouvelles semences résilientes. Elle a appris à fabriquer et à vendre du savon, complétant ainsi ses revenus et subvenant aux besoins de sa famille. La communauté, avec la participation active de ses femmes, se reconstruisait plus forte, plus résiliente et plus équitable.
Awa repense souvent à ces jours difficiles après l’inondation. Si la dévastation a été immense, elle a aussi été le point de départ d’un changement. Elle comprend maintenant que comprendre et prendre en compte les expériences différentes des hommes et des femmes n’est pas seulement une question d’équité ; c’est aussi une question de construction d’un avenir plus efficace et durable pour tous. La voix d’une femme, autrefois un murmure en temps de crise, était désormais une partie vitale du chœur de la reconstruction et de la résilience dans son village.